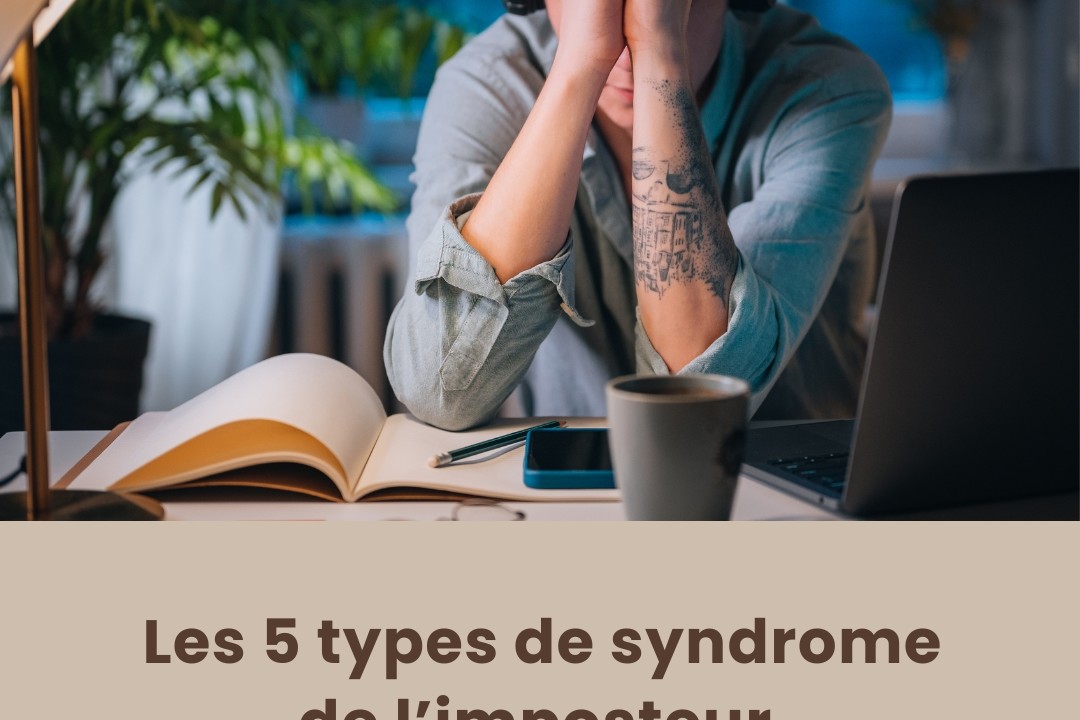Il y a quelques mois, lors d’un des premiers modules de ma formation en coaching à HEC, nous nous sommes attardés sur l’Analyse Transactionnelle, d’Éric Berne, psychiatre américain, qui développe une théorie fondée sur les 3 états du moi et qui développe des lois de la communication relatives aux interactions sociales (les transactions) et aux besoins fondamentaux.
En préambule de ce module riche et complexe (l’AT n’est pas une discipline facile à appréhender, et les travaux d’Éric Berne encore moins), nous étions invités à répondre à un questionnaire type, permettant de définir quels étaient nos « drivers ». C’est-à-dire ces petites voix en nous, qui façonnent notre façon d’agir ou d’interagir.
Il y a 5 drivers différents.
- Sois fort
- Sois parfait
- Fais plaisir
- Fais des efforts
- Dépêche-toi
J’ai donc fait le test, et ça n’a pas loupé.
Mon driver le plus fort : « Jade, sois parfaite ! » suivi de près par « Fais plaisir ».
Il est vrai que quand je regarde dans le rétroviseur de mon existence, je réalise que j’ai longtemps eu le syndrome de l’enfant modèle, dont on est toujours content, toujours satisfait. Vous savez, déléguée de classe, très bonne à l’école mais sans être marginale, qui comprend vite, qui sourit, qui est sage, qui ne pose jamais problème. Il parait même que je n’ai pas hurlé à la naissance, mais que j’ai poussé un petit cri – presque – gracieux.
Extravertie, polie, joyeuse, fantaisie, mais qui respecte les règles et ne dérange jamais. Jamais de colère, jamais d’insolence, jamais de mot dans le carnet… jamais perdre ses affaires, jamais dire non.
Et puis on me félicitait toujours pour ça. On me répétait sans arrêt comme c’était agréable que je sois de cette façon. Mes parents, mes professeurs… Alors j’ai intégré l’idée que pour être aimée, il fallait que je sois comme ça. Parfaite.
J’ai développé une exigence absolue envers moi, une intransigeance presque. Je devais toujours faire bien, toujours faire mieux. Ça a fini par se transformer en tyrannie et surtout, ça m’a coupée de mon authenticité.
J’étais prise au piège de ma volonté d’avoir une image parfaite ou d’être parfaite dans le regard de l’autre. La conséquence ? Et bien, l’obsession du contrôle. Contrôler son image, la façon dont on s’exprime, ce que l’on représente… Cette obsession de contrôler ce qu’autrui pense de nous, d’être à la hauteur de ce qu’ils projettent sur nous (ou du moins ce que l’on croit qu’ils projettent sur nous) est épuisant car c’est un combat vain, par définition, en dehors de notre zone de contrôle.
Alors lorsque l’on a cette injonction très forte de la perfection, on souffre forcément, on ressent de la colère, de la déception envers soi de ne pas arriver à atteindre cette perfection. On se demande si l’on n’atteint pas cette perfection si l’on est assez aimable au fond. Assez bien pour être accepté et intégré.
Lorsque j’étais plus jeune, j’ai beaucoup pris sur moi, beaucoup subi. Il m’était plus facile d’encaisser plutôt que d’oser me rebeller, oser décevoir, oser briser cette image que j’avais bâtie. Oser lâcher prise en fait. Lâcher prise sur tout ce contrôle, ce refus de me montrer faillible, imparfaite, qui était devenu une seconde nature.
Heureusement, j’ai fini par m’en rendre compte. Par travailler dessus.
D’ailleurs quelqu’un qui me connaît très bien m’a dit un jour, au détour d’une conversation un peu douloureuse, où je projetais sur lui avec beaucoup d’intransigeance ma quête de perfection (qu’on finit par exiger des autres aussi), « tu sais, tu cherches tellement à être parfaite que finalement ça te rend triste, car tu n’y arriveras jamais. Tu ne seras jamais à la hauteur de tes exigences, car elles sont inatteignables. Moi, quand je suis nul ou que je n’arrive pas à faire quelque chose, ça ne me dérange pas vraiment. Je me dis que ce n’est pas MA compétence, mais que je fais de mon mieux et que ce n’est pas grave si ce n’est pas parfait. »
J’ai compris ce jour-là à quel point il serait essentiel que je travaille là-dessus. Que j’apprenne à lâcher prise, à accepter ma vulnérabilité, mon imperfection… mon humanité en fait.
J’ai compris qu’avec cette tyrannie, celle que je blessais le plus, c’était moi-même. Et qu’en réalité elle me coupait des autres plus qu’elle ne m’en rapprochait. Que cette exigence exacerbée en tout m’empêchât de vivre pleinement et qu’à mesure que le temps passait, je finissais par l’attendre de mes proches. Je finissais par reproduire le schéma. Par leur faire croire qu’ils n’étaient pas non plus assez. J’ai compris aussi que ce perfectionnisme conduisait à de l’immobilisme. Combien de fois n’ai-je pas écrit cet article, fait cette vidéo, créé ce podcast ou cette entreprise car je savais qu’elle ne serait pas à la hauteur de mes exigences… Combien de fois me suis-je bridée, censurée dans mes partages, de peur d’être jugée « pas assez bien ».
Alors j’ai cherché à comprendre pourquoi. J’ai fait un énorme travail d’introspection. Je suis allée chercher très loin les réponses. Et puis j’ai fini par trouver. J’ai compris que c’était simplement le reflet d’une vieille peur. Une peur que je ne blâme pas cependant… qui vient de mon enfance, de mon parcours de vie, très sinueux. De la perte de mes repères dans des périodes clés de mon enfance et de mon adolescence. Une peur de ne pas être acceptée, intégrée. Une peur de ne pas être aimée.
Alors cette peur, je l’ai regardé droit dans les yeux, je l’ai écoutée, je l’ai comprise.
Je l’ai consolée, je l’ai rassurée. Je lui ai fait de la place et elle m’a remerciée : elle s’est faite plus discrète. Elle m’a laissée vivre. Elle m’a laissée exister, imparfaite certes, mais plus heureuse.
Je ne dis pas qu’elle ne me joue pas des tours parfois, mais maintenant on communique. On s’apprivoise. Et on avance.