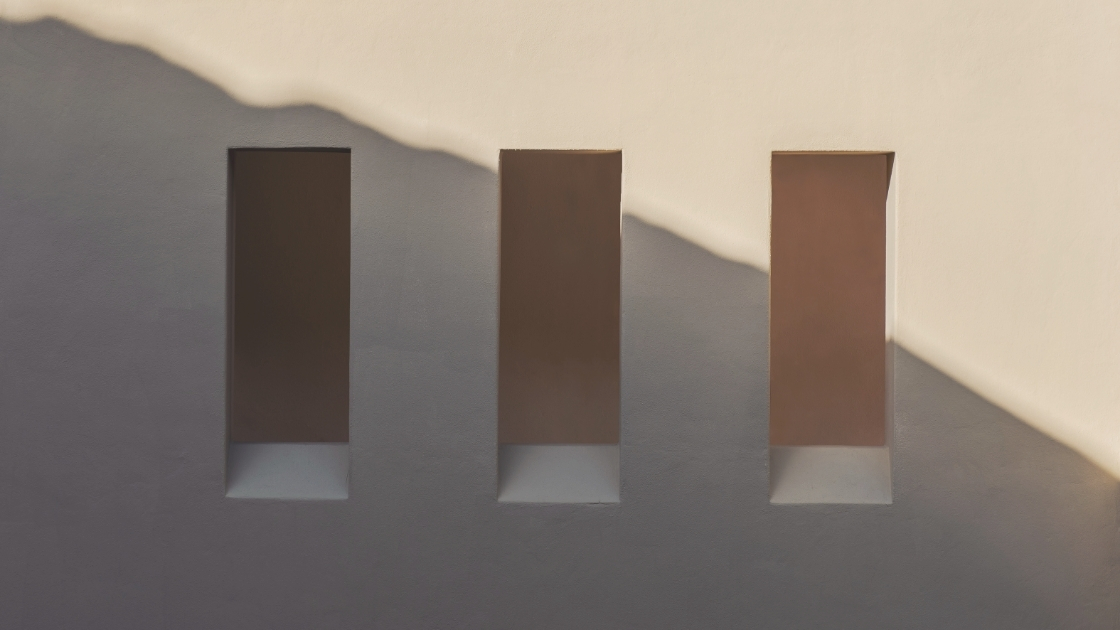La règle des trois unités
Certains souvenirs scolaires inscrits dans la cire encore molle de notre mémoire d’adolescent nous reviennent parfois, mais sous un éclairage nouveau, de manière métaphorique en quelque sorte. Ainsi en est-il pour moi de l’incontournable leçon sur le théâtre classique proférée par un enseignant hors-pair qui m’a fait aimer la littérature.
Nous avons tous ânonné à un moment de notre cursus la fameuse règle des trois unités formulées par Boileau : « Qu’en un lieu, qu’en un jour, un seul fait accompli / Tienne jusqu’à la fin le théâtre rempli ».
Notre professeur avait commencé son propos par l’analyse de l’unité de temps qui stipulait que l’action devait s’inscrire dans « une révolution du soleil », soit un maximum théorique de 24 heures. Ceci pour que la durée de cette action soit aussi proche que possible de la durée de la représentation. J’avais relevé, mais sans en mesurer la portée, un trait d’humour de notre prof de lettres : « c’est comme notre existence qui est constituée d’une seule journée ». Bien plus tard j’ai compris ce qu’il voulait dire : nos désirs, nos actes, nos projets, étaient en fin de compte construits selon la perspective d’une durée probable de notre vie humaine ; et c’est même cela qui lui conférait son intensité dramatique.
Quant à la règle de l’unité de lieu, elle impliquait que le cadre de l’action, adapté au genre (maison bourgeoise pour la comédie ; palais pour la tragédie), ne fût pas dispersé dans des espaces divers, afin que l’intrigue trouve la condition la plus propice à sa crise et son dénouement. Là encore la vie m’a appris, lorsque j’ai eu quelques décisions importantes à prendre, le rôle essentiel du lieu dans lequel j’ai « acté » tel projet, tel épisode crucial, telle entreprise…comme si mon comportement avait été « magiquement » conditionné par les circonstances concrètes, et pour ainsi dire l’ « entour » ou le « génie » du lieu.
S’agissant de l’unité d’action, notre prof de lettres, après avoir rappelé que l’intrigue, qui se résumait en « unité de péril », suivait une ligne directrice et que les actions secondaires ne faisaient qu’étayer l’événement principal, avait conclu de manière inattendue : « c’est comme dans vos dissertations : une idée par paragraphe, une idée par partie, une idée générale pour l’ensemble…et quand vous aurez mon âge, une idée pour votre existence ». Rires dans la classe. Avec le recul, on peut dire que c’était plutôt bien vu : c’est bien l’ « unité de menace » qui nous permet de nous rassembler en nous-même et de nous fédérer collectivement, en laissant de côté les éléments accessoires.
Mais j’ajoute ceci à la leçon de mon professeur : méfiez-vous de la tyrannie de ceux qui veulent vous imposer leur agenda, leur timing et leur espace favori. Inversement respectez la liberté d’autrui en négociant avec générosité unité de lieu, de temps et d’action ! Chaque existence ne se joue-t-elle pas sur la grande scène du monde à la croisée de l’espace et du temps ?
Il est vrai que ce conseil appelle une foule de questions sur la « théâtralité » de la vie sociale : celle-ci n’est-elle pas envisagée depuis toujours comme une « comédie humaine » où chacun est censé jouer un rôle conformément au système de représentation en cours (valeurs, imaginaire, idéologies propres à chaque époque et chaque culture) ; ce que les classiques avaient théorisé sous la forme d’une règle plus ou moins tacite de « bienséance ». La liberté ne consiste-t-elle pas alors à savoir se déprendre de ces scénarii conventionnels et fictifs pour inventer son existence à l’écoute de son moi profond et authentique ?
De même avaient-ils lié l’illusion théâtrale à la notion de « vraisemblance », cet « effet de réel » qui suscite l‘émotion, permettant ainsi la catharsis, ou purification des passions.
Ces considérations nous amènent à la parabole sartrienne du Garçon de Café, dans l’Etre et le Néant, cet employé zélé qui aliène son être en épousant trop étroitement sa fonction, en jouant parfaitement son rôle à travers les automatismes professionnels exigés par le regard d’autrui. Au contraire de ce comportement, la liberté et l’authenticité, s’identifieraient au dépassement du conformisme … quitte à ce que l’on soit dupe de ses propres illusions.
Ce qui fait surgir une nouvelle question : quelle est cette impulsion qui nous pousse, nous presse, à revendiquer l’autonomie de notre existence, tout en nous faisant chercher au-delà de nous-mêmes un principe organisateur, une « transcendance », comme ces « personnages en quête d’auteur » conçus par Pirandello ? A défaut de pouvoir nommer un Être suprême, auteur du grand théâtre du monde, le « sens de l’existence » relèverait d’un postulat ou d’une « hypothèse morale » que chacun aurait alors à vérifier, à expérimenter.
La bienveillance est-elle toujours souhaitable ?
À l’instar de la résilience, il y a un terme que l’on entend beaucoup, partout, c’est celui de bienveillance. Érigée comme état d’esprit à cultiver à l’égard de tous, elle est devenue, dans le monde du développement personnel notamment, la valeur reine, a priori souhaitable en toutes circonstances.
Sur le principe, et si l’on se réfère à sa définition, « disposition favorable à l’égard d’autrui », je serais tentée de dire que la bienveillance en toutes situations est plus que souhaitable. Elle témoignerait de notre capacité à accorder une confiance absolue en l’autre, par principe, à l’accueillir pleinement et sans jugement et à lui accorder le bénéfice du doute.
Je me questionne en revanche sur le visage qu’a pris l’idée de la bienveillance dans la société et dans nos différents comportements humains. Lorsqu’elle est évoquée, expliquée, incarnée, j’observe et perçois une forme d’injonction dans le discours.
Une injonction à tout accepter et à tout tolérer. Une injonction à l’ouverture sans limites. Une injonction à nier les émotions négatives et la contradiction. J’entends aussi, parfois, une ode à la pensée unique, bienveillante donc, qui exclut parfois les débats d’idées et la hiérarchisation de la parole notamment.
En effet, la bienveillance n’est-elle pas en train de basculer dans une forme de complaisance ? Dans une absence de sincérité, à soi et aux autres, qui empiète sur notre désir d’affirmation et notre besoin profond d’émulation ?
Je me questionne réellement. Car si je crois profondément à la bienveillance, je crois aussi que l’idée que l’on s’en fait communément et la manière dont elle est incarnée dans la société, sorte de fade amabilité, est un danger. Un danger car il nous enferme dans le polissage de l’ego, dans le refus de la remise en question, dans l’absence de progrès et d'exigence et dans l’appauvrissement des échanges humains, qui ont résolument besoin de sincérité pour être sublimés. Pour être transcendés.
« La colère est la rage du cœur ». J’ai noté cette citation lors d’une conférence de philosophie avec Elsa Godart la semaine dernière.
Et bien moi, ce nivellement par le bas de la pensée, sous couvert de bienveillance, me met en colère. Mon cœur vibre pour la rencontre brute et authentique des êtres, de leur génie, de leurs ego, de leurs ombres, de leurs pensées et de leurs émotions. Et chercher à les lisser, à les adoucir, à les édulcorer, toujours plus, me semble être non seulement un fléau mais surtout un combat vain.
Aristote disait de la bienveillance que c’est « l’amitié fainéante » et développe dans son œuvre ce qu’est selon lui « l’amitié vertueuse », exigeante et franche, la seule qui compte. Comme souvent, les philosophes de cette époque résonnent beaucoup chez moi.
D’ailleurs, et en marge de cette réflexion globale, cela me fait penser qu’il est intéressant d’observer que cette tendance s’accompagne, dans l’anonymat des réseaux sociaux notamment, d’un mouvement opposé, caractérisé par son approche sectaire, violente et dogmatique, qui fait justement fi de toute forme de bienveillance. Encore une fois, on peut constater avec un étonnement quelque peu ironique, que la société fonctionne dans une forme de schizophrénie.
Mais puisque je suis une profonde optimiste, je ne saurai terminer cet article sans une proposition, une ouverture, une suggestion.
Et si nous choisissions, plutôt que l’illusion de la bienveillance, la sincérité en toute circonstance ? Comme un phare, qui toujours, éclaire nos comportements. Une ligne de conduite de fidélité et de loyauté à soi, qui nous délivre des malentendus, nous rapproche de notre vérité et nous offre la liberté.
Ainsi, cela ne redonnerait-il pas ses lettres de noblesse à la bienveillance, base fertile, qui, associée à cette profonde sincérité, redeviendrait le terreau de la tolérance et du progrès ?
Tempête sous un crâne
Dans un précédent billet, je comparais la vie de la conscience à une navigation à l’intérieur du triangle formé par le souci individualiste de soi, l’exigence intime de l’intérêt collectif et la prise en compte d’un besoin « métaphysique » d’absolu. La plupart du temps on arrive à coordonner les desiderata de ces trois instances du « je », et, malgré quelques intermittences du cœur, quelques doutes ou hésitations, la navigation se déroule sans encombre. Mais il y a parfois tempête sous le crâne, autrement dit une « crise de conscience », moment crucial où nos valeurs et notre être profond sont mises à l’épreuve.
La littérature a bien sûr exploré cette zone de l’existence où les philosophies de beau temps ne sont plus de mise. Les lecteurs des Misérables de Victor Hugo se remémorent le douloureux débat intérieur de Jean Valjean, lorsqu’il apprend qu’un innocent va être condamné aux galères à sa place. Les nostalgiques du bac philo se souviennent de l’exemple canonique proposé par Sartre : un étudiant vient lui demander conseil pour savoir, alors que la France vient d’être envahie par les armées nazies, s’il doit rejoindre la Résistance à l’étranger, ou rester auprès de sa mère au nom de son devoir filial. Sartre lui répond que c’est son choix qui fixera ses valeurs et donc sa définition de la liberté. Camus dans un autre contexte de guerre avait affirmé : « Entre la justice et ma mère, je choisis ma mère ».
On le voit, les cas de conscience sont des moments privilégiés de la vie intérieure, permettant une nouvelle naissance à soi, un dialogue de vérité, supplantant ainsi l’autre versant de la (mauvaise) conscience : la dialectique du regret, du repentir et du remords qui est un classique de la réflexion morale et que j’évoquerai dans un autre feuillet.
Mais partons d’un exemple actuel pour sonder les turbulences de la conscience contemporaine et ses tiraillements entre le bien-être individuel, l’intérêt collectif de la nation et le devoir humanitaire. À une époque où les migrations de populations vont s’amplifier par nécessité vitale (ce ne seront plus des « émigrations » choisies et régulées), des attitudes s’opposent et s’opposeront violemment en fonction de l’issue donnée à la crise de conscience (toute crise étant une obligation de se déterminer et de choisir ses valeurs) : certains n’ont même pas besoin de débat pour réaliser leur synthèse : le primat de la solidarité humaine s’impose sans conteste. D’autres, se plaçant d’un point de vue politique argueront de la nécessité de prendre en compte le maintien de notre tradition et de notre culture, ce qui amène à réguler les flux migratoires (je ne parle pas des hystériques nationalistes qui évoquent « un génocide par substitution »). Quant au point de vue individualiste, il est affecté bien sûr par les incidences personnellement vécues du phénomène collectif dont il est question.
La philosophie peut sembler ici impuissante ; elle nous apprend seulement à ne pas laisser le champ de la conscience être totalement envahi par la tyrannie de nos opinions et à privilégier notre devoir d’humanité.
Sois parfaite Jade !
Il y a quelques mois, lors d’un des premiers modules de ma formation en coaching à HEC, nous nous sommes attardés sur l’Analyse Transactionnelle, d’Éric Berne, psychiatre américain, qui développe une théorie fondée sur les 3 états du moi et qui développe des lois de la communication relatives aux interactions sociales (les transactions) et aux besoins fondamentaux.
En préambule de ce module riche et complexe (l’AT n’est pas une discipline facile à appréhender, et les travaux d’Éric Berne encore moins), nous étions invités à répondre à un questionnaire type, permettant de définir quels étaient nos « drivers ». C’est-à-dire ces petites voix en nous, qui façonnent notre façon d’agir ou d’interagir.
Il y a 5 drivers différents.
- Sois fort
- Sois parfait
- Fais plaisir
- Fais des efforts
- Dépêche-toi
J’ai donc fait le test, et ça n’a pas loupé.
Mon driver le plus fort : « Jade, sois parfaite ! » suivi de près par « Fais plaisir ».
Il est vrai que quand je regarde dans le rétroviseur de mon existence, je réalise que j’ai longtemps eu le syndrome de l’enfant modèle, dont on est toujours content, toujours satisfait. Vous savez, déléguée de classe, très bonne à l’école mais sans être marginale, qui comprend vite, qui sourit, qui est sage, qui ne pose jamais problème. Il parait même que je n’ai pas hurlé à la naissance, mais que j’ai poussé un petit cri – presque – gracieux.
Extravertie, polie, joyeuse, fantaisie, mais qui respecte les règles et ne dérange jamais. Jamais de colère, jamais d’insolence, jamais de mot dans le carnet… jamais perdre ses affaires, jamais dire non.
Et puis on me félicitait toujours pour ça. On me répétait sans arrêt comme c’était agréable que je sois de cette façon. Mes parents, mes professeurs… Alors j’ai intégré l’idée que pour être aimée, il fallait que je sois comme ça. Parfaite.
J’ai développé une exigence absolue envers moi, une intransigeance presque. Je devais toujours faire bien, toujours faire mieux. Ça a fini par se transformer en tyrannie et surtout, ça m’a coupée de mon authenticité.
J’étais prise au piège de ma volonté d’avoir une image parfaite ou d’être parfaite dans le regard de l’autre. La conséquence ? Et bien, l’obsession du contrôle. Contrôler son image, la façon dont on s’exprime, ce que l’on représente… Cette obsession de contrôler ce qu’autrui pense de nous, d’être à la hauteur de ce qu’ils projettent sur nous (ou du moins ce que l’on croit qu’ils projettent sur nous) est épuisant car c’est un combat vain, par définition, en dehors de notre zone de contrôle.
Alors lorsque l’on a cette injonction très forte de la perfection, on souffre forcément, on ressent de la colère, de la déception envers soi de ne pas arriver à atteindre cette perfection. On se demande si l’on n’atteint pas cette perfection si l’on est assez aimable au fond. Assez bien pour être accepté et intégré.
Lorsque j’étais plus jeune, j’ai beaucoup pris sur moi, beaucoup subi. Il m’était plus facile d’encaisser plutôt que d’oser me rebeller, oser décevoir, oser briser cette image que j’avais bâtie. Oser lâcher prise en fait. Lâcher prise sur tout ce contrôle, ce refus de me montrer faillible, imparfaite, qui était devenu une seconde nature.
Heureusement, j’ai fini par m’en rendre compte. Par travailler dessus.
D’ailleurs quelqu’un qui me connaît très bien m’a dit un jour, au détour d’une conversation un peu douloureuse, où je projetais sur lui avec beaucoup d’intransigeance ma quête de perfection (qu’on finit par exiger des autres aussi), « tu sais, tu cherches tellement à être parfaite que finalement ça te rend triste, car tu n’y arriveras jamais. Tu ne seras jamais à la hauteur de tes exigences, car elles sont inatteignables. Moi, quand je suis nul ou que je n’arrive pas à faire quelque chose, ça ne me dérange pas vraiment. Je me dis que ce n’est pas MA compétence, mais que je fais de mon mieux et que ce n’est pas grave si ce n’est pas parfait. »
J’ai compris ce jour-là à quel point il serait essentiel que je travaille là-dessus. Que j’apprenne à lâcher prise, à accepter ma vulnérabilité, mon imperfection… mon humanité en fait.
J’ai compris qu’avec cette tyrannie, celle que je blessais le plus, c’était moi-même. Et qu’en réalité elle me coupait des autres plus qu’elle ne m’en rapprochait. Que cette exigence exacerbée en tout m’empêchât de vivre pleinement et qu’à mesure que le temps passait, je finissais par l’attendre de mes proches. Je finissais par reproduire le schéma. Par leur faire croire qu’ils n’étaient pas non plus assez. J’ai compris aussi que ce perfectionnisme conduisait à de l’immobilisme. Combien de fois n’ai-je pas écrit cet article, fait cette vidéo, créé ce podcast ou cette entreprise car je savais qu’elle ne serait pas à la hauteur de mes exigences… Combien de fois me suis-je bridée, censurée dans mes partages, de peur d’être jugée « pas assez bien ».
Alors j’ai cherché à comprendre pourquoi. J’ai fait un énorme travail d’introspection. Je suis allée chercher très loin les réponses. Et puis j’ai fini par trouver. J’ai compris que c’était simplement le reflet d’une vieille peur. Une peur que je ne blâme pas cependant… qui vient de mon enfance, de mon parcours de vie, très sinueux. De la perte de mes repères dans des périodes clés de mon enfance et de mon adolescence. Une peur de ne pas être acceptée, intégrée. Une peur de ne pas être aimée.
Alors cette peur, je l’ai regardé droit dans les yeux, je l’ai écoutée, je l’ai comprise.
Je l’ai consolée, je l’ai rassurée. Je lui ai fait de la place et elle m’a remerciée : elle s’est faite plus discrète. Elle m’a laissée vivre. Elle m’a laissée exister, imparfaite certes, mais plus heureuse.
Je ne dis pas qu’elle ne me joue pas des tours parfois, mais maintenant on communique. On s’apprivoise. Et on avance.
Money Money Money
Il y a un sujet sur lequel j’ai beaucoup travaillé ces derniers mois, que ce soit en thérapie ou pendant ma formation en coaching, c’est mon rapport à l’argent. J’ai identifié que j’avais un vrai sujet autour de l’argent, quand en parler était pour moi un peu tabou, mais surtout lorsque j’ai commencé à entreprendre.
Je me suis rendue compte que j’avais beaucoup de mal à fixer quelle était « ma valeur commerciale » ou quelle était la valeur commerciale des services proposés par ma société. Et quand bien même, j’arrivais à passer cette étape douloureuse, j’avais encore plus de mal, ensuite, à assumer cette valeur. À l’afficher et à la « réclamer » de mes clients, qui pourtant avaient TOUS fait la démarche de venir vers moi et la volonté de travailler avec moi, pour ce que je savais faire, ou ce que j’étais.
Alors pourquoi cet inconfort ?
Cet inconfort à envoyer un devis. Cet inconfort à afficher mes tarifs ? Cet inconfort à parler de mes dépenses, de mes besoins … Comme si j’avais du mal à assumer qui j’étais, du mal à assumer mes compétences, mes talents, mes exigences, mon style de vie.
Je crois qu’avoir grandi dans une famille de profs (mes deux parents étant maîtres de conférences) n’a pas aidé. Je n’étais tout simplement pas habituée à parler d’argent. À le manipuler, à le négocier. Je n’avais pas été formée à appréhender l’autre par ce prisme de l’argent. Dans ma famille, même éloignée (tantes, oncles, cousins…), et des deux côtés qui plus est, il n’y a quasiment que des professeurs, fonctionnaires, hauts-fonctionnaires, infirmiers, directeurs de formation… alors je crois que ce manque de référent a joué un grand rôle dans mon malaise vis-à-vis de l’argent.
Mais il fallait que j’apprenne, que je change, que je progresse, parce que moi, depuis plusieurs années maintenant, j’avais choisi d’être dans le privé, et même… d’entreprendre. Alors par définition, l’argent serait au centre de mes préoccupations, de mes discussions et de mes décisions.
J’ai donc beaucoup exploré. J’ai bossé sur moi et sur ce malaise. J’ai cherché à comprendre ce qu’il y avait derrière cet inconfort. En creusant, j’ai compris que plusieurs éléments rentraient en ligne de compte.
- J’avais une vielle croyance, bien persistante, qui me disait « les gens changent à cause de l’argent. Ils deviennent plus mesquins, plus fourbes, sont de mauvaise foi et prêts à tout pour te rouler. L’argent en fait, coupe l’Homme de son humanité ».
Il m’a fallu du temps pour le verbaliser, mais c’était la vérité. Voici quel était secrètement ma croyance vis-à-vis de l’argent.
- Un sentiment d’illégitimité. En explorant, je suis aussi allée creuser mon syndrome de l’imposteur. Je suis une femme, « jeune », sensible… et bien que talentueuse, compétente, diplômée, j’avais ce sentiment de non-légitimité qui me collait à la basket comme un vieux chewing-gum. J’avais le sentiment qu’on ne me prenait pas toujours au sérieux. Qu’il fallait que je fasse toujours plus, toujours mieux, pour « mériter » mes revenus, perçus parfois comme « trop importants ».
Heureusement, j’ai aussi investi en temps et en énergie pour bosser là-dessus et dépasser cet écueil.
- Enfin, je crois qu’il y a derrière cet inconfort, une peur. La peur de tout perdre. La peur de se retrouver dans le besoin. La peur de manquer. Inconsciemment, je me disais peut-être, si je ne gagne pas grand-chose, au moins, je n’ai pas grand-chose à perdre. Si je ne m’habitue pas à un rythme de vie luxueux, je ne serai malheureuse, si un jour je viens à manquer d’argent. La peur de faire les mauvais choix aussi. Et si je ne suis pas capable de gérer mon argent (puisque je n’y suis pas habituée, puisque je ne sais pas comment faire), que va-t-il se passer ? Vais-je tout flamber ? Vais-je faire les mauvais choix ? Investir maladroitement ?
Vous l’aurez compris, l’argent, était un vrai sujet pour moi qu’il était essentiel de travailler et de dépasser. Cela était essentiel pour mon confort émotionnel d’une part (se retrouver en situation de stress lorsque l’on doit « négocier » en étant entrepreneuse n’est pas viable à long terme) mais aussi essentiel pour le développement économique et la pérennisation de mes activités.
Par ailleurs, j’ai compris aussi que l’argent n’est que la représentation concrète, matérielle, de la valeur que l’on a de soi. Et lorsque que j’ai compris ça, tout a commencé à aller mieux.
Car ma valeur, je la connais. J’ai confiance en moi et en mes capacités. En mon talent. En ma capacité à m’engager et à me dépasser pour mes clients. Alors il est tout naturel que je sois payée, et bien, pour tout ce que je leur offre de moi-même. Ce qu’il y a de mieux en moi. Mon savoir-faire, mais aussi mon savoir-être, mon éducation, mon sérieux, ma volonté, ma rigueur. Là alors, j’ai pu apposer des chiffres de manière plus sereine.
Autre élément déterminant, et ça je le tiens de ma thérapeute, déterminer ses tarifs, les assumer, les porter au monde, c’est aussi assumer son mode de vie et par extension, son identité. Il faut être lucide sur la réalité de notre quotidien : oui, habiter à Paris coûte cher, se déplacer coûte cher, être outillé des dernières technologies pour effectuer son métier coûte cher, manger bio, faire du sport, se former, voyager… tout cela coûte cher et il n’y a aucun problème à se battre et à travailler pour satisfaire ses besoins.
J’espère vous avoir éclairé si vous aussi, vous avez actuellement ou avez eu par le passé une problématique similaire et que ce retour d’expérience, tant sur le processus de gestion et de dépassement que via les conseils pratiques qui m’ont aidée à passer à l’action, vous sera utile.
Le triangle de la conscience
Pour introduire le thème philosophique suggéré par le titre de cet article quelque peu énigmatique, permettez-moi de partir de mon expérience de navigateur. En effet en navigation côtière, avant l’usage du GPS, on était amené à « faire le point », à se situer sur une carte nautique, en procédant par « triangulation » : grâce à un compas de relèvement (boussole portative, en quelque sorte), on se référait à deux points remarquables sur la côte (points appelés « amers »), ce qui permettait de faire se croiser deux lignes au point précis où se trouvait le navire. Le triangle ainsi formé donnait un repère, une visibilité, je n’ose pas dire « une conscience », à ce bateau.
La vision trinitaire de la subjectivité qui s’est imposée au début du XXème siècle est due, comme chacun sait à Freud, qui à nommé « topique » la triade des points de vue, des « instances » dont se compose chaque sujet humain : le « moi » désireux d’être maître chez soi, en pleine conscience de ses actions, souvent sous tension, dans des rapports de force avec le « ça », autre instance constituée d’un faisceau de pulsions (au premier chef, la sexualité avec ses alliés de la libido, parmi lesquels cet « instinct de mort » qui nous suggère de nous fondre dans la matière inerte pour trouver la quiétude éternelle) ; et, troisième instance formant un triangle avec les deux précédentes, le « surmoi » coalisant sous sa bannière les idéaux, les devoirs, la morale avec toutes ses figures d’autorité.
La religion avait déjà exploré, sous un autre angle, la conscience de l’homme configurée selon un absolu, un Dieu trinitaire, démultiplié en trois « personnes » (les théologiens ont finalement préféré ce terme à celui trop savant d’« hypostases ») : un Être infini, « paternel », reliant tous les humains dans l’intuition de leur « fraternité » ; une personne incarnant l’amour de cet Être « parental », personne « christique », c’est-à-dire exemplaire au premier titre ; enfin, troisième instance, l’Esprit autrefois appelé Paraclet, c’est-à-dire le Médiateur.
Cette Trinité est donc fondée non sur des rapports de force, mais sur la relation d’amour qui maintient la triangulation divine. Les premiers chrétiens interrogeaient ainsi l’Esprit pour savoir comment ils pouvaient se conduire à l’imitation du Christ, dans l’amour de Dieu.
Quelques siècles auparavant, un philosophe grec, Aristote, avait défini une topique philosophique, constituée de la triade suivante : l’individu, soucieux de satisfaire son moi ; le citoyen pour qui l’identité collective de la Cité importait seule ; le philosophe, enfin, qui donnait la priorité à l’être humain dont il se sentait dépositaire au plus intime de lui-même. Le prédécesseur d’Aristote, celui qui fut son maître, Platon, voyait, lui, trois notions fondamentales au firmament des idées : le Vrai, le Beau et le Bien.
Alors aujourd’hui, quel homme trinitaire inventer ? Certains proposeront cette triade : l’individu ; l’être social ; l’homme dans son identité biologique. Mais on pourrait aussi bien envisager trois manières d’en user avec le Temps : la durée individuelle d’une existence, entre la naissance et la mort, condition nécessaire à l’expression des désirs et des projets de chacun de nous ; la durée historique et sociale de notre « être collectif » qui prend des formes variables, intergénérationnelles et humanistes ; enfin l’aspiration à l’éternité, ce besoin d’absolu, de hors-temps, qui nous évite de rester englués dans le devenir du monde…
L’important, n’est-il pas qu’aucune de ces temporalités, aucune de ces instances, ne veuille imposer sa tyrannie aux deux autres ?